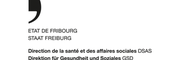Comment se déroule une grossesse ?
Dernière modification le 13 janvier 2025
La grossesse est la période qui va de la fécondation à la naissance. Elle dure entre 280 et 290 jours (environ 9 mois).
La fécondation
Pour qu’il y ait une fécondation, il faut qu’au moins un spermatozoïde remonte dans le vagin, passe le col de l’utérus et atteigne un ovule. Il faut donc qu’il y ait eu une ovulation (en moyenne, elle a lieu aux alentours du 14e jour du cycle menstruel, soit 14 jours après le premier jour des dernières menstruations).
Quand un spermatozoïde rencontre un ovule, ils forment ensemble un oeuf, qui va devoir s’implanter dans l’utérus. Ce « nid » se produit sur l’endomètre entre le 5e et le 7e jour après la fécondation.
Le premier trimestre
Le développement de l’embryon est très rapide pendant les 3 premiers mois. Les organes principaux apparaissent dès le 2e mois. Le ventre enceint grossit en général à partir de ce moment-là. A la fin du 3e mois, l’embryon est appelé un « foetus ». Il mesure alors entre 7 et 8 cm.
Il se peut que la personne ne réalise pas qu’elle est enceinte avant la fin du premier mois.
C’est que le premier signe de la grossesse est l’absence de règles (aménorrhées). La personne peut cependant avoir déjà des symptômes : grande fatigue, tensions, voire douleurs, dans la poitrine, nausées, troubles de l’humeur, variation de poids, maux de tête ou d’estomac, changement des goûts et de l’alimentation, …
Pour confirmer ces symptômes, le test de grossesse peut être effectué dès 7 jours après le premier jour attendu des règles. Dès que la grossesse est constatée, il est recommandé de faire une première échographie.
Le développement du foetus
L’embryon se développe dans l’utérus, où il est entouré d’une membrane qu’on appelle le « sac amniotique ». Ce « sac » est remplit de liquide amniotique, stérile, qui protège le foetus des chocs et des infections. En prélevant ce liquide, le corps médical peut suivre la santé du foetus, parce qu’il y rejette des cellules ou de l’urine. A la fin de la grossesse, ce « sac » se perce et se vide, on dit qu’une personne « perd les eaux ».
Le foetus se nourrit grâce au cordon ombilical qui le relie au placenta, un organe rempli de nutriments et d’oxygène. Le placenta est constitué de l’endomètre et collé contre la paroi de l’utérus. Quelques minutes après la naissance, il est évacué par le vagin. On appelle cela « la délivrance ».
Les difficultés les plus fréquentes
Dans la très grande majorité des cas, les grossesses, en Suisse, se déroulent sans complication importante. Certains désagréments sans gravité sont souvent observés, comme des maux de dos ou d’estomac, des constipations, des hémorroïdes ou la rétention d’eau, des troubles du sommeil ou des contractions ponctuelles.
Les grossesses font l’objet d’un suivi médical pendant lequel tu peux poser toutes les questions qui te préoccupent.
Si l’un de ces symptômes se présente, il est conseillé de consulter rapidement le·la médecin qui te suit (généraliste, gynécologue, sage-femme) :
- Contractions utérines régulières et importantes avant la 37e semaines de grossesse
- Perte des eaux ou de liquide amniotique
- Saignements ou douleurs en urinant
- Maux de tête importants, avec troubles de la vue
- Diminution nette des mouvements du bébé
- Chute, coups, accidents
- Fièvre (38°C et +)
Les congés parentaux
En Suisse, le congé parental est différent entre les femmes qui ont porté l’enfant et les pères. Il n’y a pas de congé parental pour une mère qui n’a pas porté l’enfant, car elle doit d’abord l’adopter.
Le congé dit « maternité » est prévu pendant 14 semaines après la naissance pour les femmes inscrites à l’AVS et pendant 8 semaines pour les femmes qui ne le sont pas. Pendant ce temps, les mères reçoivent une allocation de maternité.
Les employeur·euse·s n’ont pas le droit de la licencier pendant la grossesse et les 16 semaines qui suivent l’accouchement. Les pères, s’ils sont assurés à l’AVS, ont droit à 2 semaines de congé paternité avec une allocation dédiée.
Les spécialistes du suivi de la grossesse
Les grossesses sont suivies par des gynécologues, des gynécologues-obstétricien·ne·s et/ou par des sage-femmes. Ces spécialistes s’occupent des échographies et des différents diagnostics pendant la grossesse pour assurer le bon développement du foetus, sa santé et celle de la personne enceinte.
Les généralistes interviennent parfois également selon les besoins.
Il est aussi possible de faire appel à un·e doula, qui accompagne la grossesse et l’accouchement.
Pour les personnes qui travaillent, il est recommandé de faire une consultation spécialisée en médecine du travail afin d’adapter le poste et le cahier des charges si besoin.
Si des pathologies se déclarent pendant la grossesse, d’autres spécialistes peuvent intervenir, comme les technicien·ne·s en radiologie médical, les généticien·ne·s, les chirurgien·ne·s.
Articles en lien
voir plusDéni de grossesse et grossesse nerveuse
Parfois, le corps peut masquer les symptômes d’une grossesse existante (déni de grossesse) ou imiter les symptômes d’une grossesse absente (grossesse nerveuse).
Comment faire un test de grossesse ?
Il existe deux manières de vérifier qu’il y a une grossesse : les tests sanguins, réalisés par un·e médecin, et les tests urinaires, que tu peux réaliser chez toi ou dans un espac…
Désir ou non-désir d’enfant
Le choix de faire ou non un enfant est un droit humain fondamental. Tu en as envie, pas envie ? Seul·e, en couple hétérosexuel ou homosexuel ? De manière biologique, en adoptant ?
Questions sur ce thème
voir plusEst-ce que je peux faire un changement de nom en même temps que ma naturalisation ?
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne catégorie, mais il n'y a rien pour le genre... Je suis en dans des démarches de naturalisation et je voulais savoir si c'est possible de f…
Je ne supporte plus de me voir dans un miroir
C est un peu gênant pour moi mais j’ai besoin d’en parler du coup sa fait depuis l’âge de 12-13 ans que je me masturbe j’en est marre sa a commencé à quand des “amis” mon consei…
J'ai pas mal de questions en sexualité
Hello hello, je vous contacte car jai pas mal de questions. Pour contextualiser, je suis en coupe depuis 2 mois avec un garçon et ça se passe super bien ! Il s'agit de ma première…